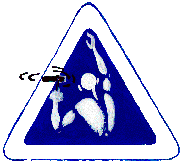 | HEPATITE ET PAS TOI ? |
|
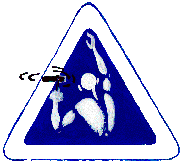 | HEPATITE ET PAS TOI ? |
|
|
|
L'épidémie liée au virus C de l'hépatite aurait trois siècles. 0,5 à 5 % des habitants du globe sont concernés, 1 % dans notre pays. Dès le début du prochain millénaire, le problème relèvera de la santé publique.
On le sait maintenant avec certitude : la plupart des cas d'hépatite C sont liés à une transmission parentérale. Transfusion sanguine et toxicomanie intraveineuse ont été les grands vecteurs. Dans près de 30% des cas, aucun facteur de risque n'est mis en évidence, sans doute parce que l'enquête n'est pas assez fouillée, ou parce que la transfusion responsable, peropératoire, n'a jamais été signalée.
|
Si de nombreux produits sanguins ont été impliqués - concentrés plaquettaires ou globulaires, culots, plasma, fractions coagulantes -, l'albumine n'a jamais été contaminante, son mode de préparation éliminant le risque. Quelques lots d'immunoglobulines Gamma-gard ont été suspectés : les lots n'avaient pas subi d'inactivation virale. Tous les lots ont été rappelés et testés et tous les sujets ayant reçu ces immunoglobulines ont été testés par PCR (la sérologie pouvant n'être pas informative chez des sujets immunodéprimés). 8% des sujets traités avec le lot incriminé auraient été contaminés par cette voie. Curieusement, tous les receveurs du même lot n'étaient pas contaminés. A l'heure actuelle, toutes les immunoglobulines sur le marché français ont subi une inactivation virale.
Pour l'ensemble des produits sanguins, le dépistage systématique de tous les dons par des tests de troisième génération a diminué le risque théorique de transmission : le taux d'hépatite C post-transfusionnelle passe de 6% en 1980 à moins de 0,5% en 1996. La transmission du virus n'est plus désormais possible que lors de l'injection de produits sanguins labiles dont le don a été effectué au moment de la fenêtre sérologique ou dans le cadre d'une erreur humaine au moment du dépistage biologique. Ce risque résiduel, considéré comme infime, est estimé à 1 don de sang sur 220 000.
|
Les contaminations nosocomiales ont été impliquées. L'hémodialyse a entraîné le passage du virus de malade à malade, même en l'absence de transfusions, comme le montrent les études du génome viral parmi des patients infectés par la même souche. Une étude belge, portant sur plus de 400 dialysés, estime que, dans un centre d'hémodialyse, l'incidence annuelle de contamination par le VHC est de 1,7%. L'environnement de la dialyse, soins infirmiers et matériel de dialyse, est en cause. Les chiffres de prévalence varient selon les pays et les centres, de 10 à 60%.
Aucune solution préventive sûre n'a réduit la transmission à zéro. Certains spécialistes prônent la séparation des malades selon qu'ils sont séropositifs ou séronégatifs au VHC.
En unité de transplantation, les malades subissent , outre la greffe, des transfusions répétées. Un risque résiduel non nul de transmission par l'organe greffé subsiste. Il est lié à la possibilité de prélèvement pendant la phase de silence sérologique ou à la réalisation du dépistage sur le sang d'un donneur très hémodilué par les perfusions. En 1995, 5.7% des donneurs d'organes prélevés sur Paris étaient séropositifs pour le VHC. Les futurs greffés du rein ou du coeur, souvent polyhospitalisés et polytransfusés, sont par ailleurs contaminés par le VHC (environ 25% des transplantés rénaux et 30% des transplantés cardiaques).
En chirurgie, la contamination nosocomiale est exceptionnelle (une transmission de chirurgien à malades démontrée).
L'endoscopie digestive semble avoir été un facteur de risque avant la désinfection poussée des endoscopes telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée. La recherche d'ARN viral s'est toujours révélée négative après une décontamination correcte du matériel.
Bien que la contamination par ces voies n'ait jamais été formellement prouvée, tatouages et piercing effectués dans de mauvaises conditions ont pu être responsables.
|
En cas de piqûre avec une aiguille contaminée et d'hépatite aigüe consécutive, il est aujourd'hui conseillé de traiter précocement le sujet infecté.
|
Dans les couples hétérosexuels dont l'un des partenaires est infecté, on n'a pas démontré le passage sexuel du virus. L'ARN viral n'a pas été retrouvé dans les sécrétions vaginales et sa présence dans le liquide spermatique est démentie. En outre, la présence d'ARN ne signe pas l'infectiosité, la contagiosité dépendant sans doute de la concentration en virions et de la présence éventuelle d'anticorps neutralisants.
On peut cependant noter que le virus a, rarement, été mis en évidence dans le sang. Cela conduit les experts à recommander l'usage du préservatif pendant les règles, lorsqu'il existe des ulcérations génitales, ou lors de rapports sexuels traumatisants. Il n'est pas recommandé dans les autres situations.
Au sein des familles, des contaminations non sexuelles ont été mises en évidence. L'utilisation conjointe de rasoirs, de brosses à dents, semble être en cause. Un faible niveau socio-économique est un facteur de risque de transmission, celle-ci semblant liée à la promiscuité. Une transmission par le rasoir d'un barbier a été démontrée.
|
Si la sérologie du VHC n'est pas obligatoire au cours de la grossesse, elle est cependant recommandée pour les anciennes toxicomanes, les transfusées ou les malades ayant présenté une hépatite non étiquetée.
L'allaitement n'est pas documenté comme facteur de risque.
|
|
Dans les années à venir, le diagnostic sera porté plus souvent. La population est mieux informée, les médecins généralistes sont sensibilisés, peu à peu les anciens transfusés, les toxicomanes sont testés. Le VHC est le plus souvent mis en évidence lors d'une sérologie pour don ou après la constatation d'une augmentation des transaminases. Il serait souhaitable que l'infection soit connue le plus tôt possible pour que le patient bénéficie d'un éventuel traitement. Même si l'interféron est relativement mal supporté et ses échecs nombreux, il permet de guérir environ un malade sur quatre ou cinq.
En raison de la longueur de la phase asymptomatique et du nombre de cas restant à dépister, l'histoire de l'hépatite C reste à écrire. Les chapitres sur les traitements et sur le vaccin sont loin d'être clos.
|
Quelle stratégie de dépistage adopter ? Un dépistage systématique a été écarté. Certains facteurs de risque ont une valeur prédictive positive faible. Prenons par exemple le critère "séjour dans un pays en voie de développement". Il sélectionne 43% de la population pouur une valeur prédictive positive de 1,7%. Il n'est donc pas raisonnable de s'y arrêter. En revanche, si l'on sélectionne les sujets associant une toxicomanie intraveineuse ancienne et une transfusion avant 1991 avec des Alat supérieurs à 1,2 fois la normale, la valeur prédictive est élevée (7%) avec une sensibilité de 82% et une spécificité de 87%.
Le dépistage repose donc soit sur des facteurs de risque (seules toxicomanies et transfusion ancienne sont des facteurs suffisants en soi), soit sur des critères biologiques (la présence du VHC étant recherchée sur une valeur d'Alat augmentée, repérée par hasard en médecine de ville ou lors d'un examen systématique). Ces critères de sélection du dépisté ignorent cependant un élément essentiel : le patient.
Le dépistage trouve son intérêt dans l'existence d'un traitement, pour le moment par l'interféron. Des améliorations cliniques et biologiques sont décrites par toutes les études, dans une proportion cependant variable. Mais les bénéfices à long terme (taux de survie, par exemple), restent à préciser.
Les coûts induits, non seulement par le dépistage, mais également par les examens secondaires à la mise en évidence de la contamination, ne peuvent être ignorés. Le risque des explorations secondaires, en particulier de la ponction-biopsie du foie, ne peut être occulté. Quoique rare (0,04 % en moyenne), le décès au cours de cet examen est-il acceptable chez un maladde qui va le plus souvent bien, dont on ignore le devenir clinique et pour lequel les bénéfices thérapeutiques ne peuvent être assurés à priori.
Ces questions fondamentales n'ont pas été évoquées par des généralistes rétrogrades, mais par des experts en santé publique, comme le Dr Desenclos, en virologie, comme le Pr Goudeau, ou par des cliniciens comme le Pr Françoise Degos.
Ces questionnements ont abouti à des propositions concrètes, comme celles du Dr Deugnier, qui, après avoir souligné le caractère vulnérant de la ponction-biopsie hépatique, rappelait la nécessité de développer une alternative diagnostique, la recherche d'autres marqueurs de fibrose ou le recours à des indices motivés, qui restent à définir et permettant de se passer de la biopsie. La communication de Françoise Degos a fait passer un courant électrique dans l'amphitéâtre du consensus. Chargée de plancher sur les objectifs des traitements antiviraux de l'infection, elle a regretté de ne pouvoir disposer de données fondamentales, dont l'absence empêche des conclusions tranchées.
Alors que l'on peut affirmer face à une hépatite aigüe que le traitement par interféron est utile et nécessaire, on ne peut être aussi affirmatif face à une hépatite chronique. En dehors de l'hépatite aigüe, il n'existe pas de preuve formelle de la nécessité de recourir au traitement par interféron. Cela ne veut pas dire que ce traitement soit inutile, mais qu'il faut en préciser le but. Aucune étude ne permet d'affirmer à l'heure actuelle qu'il prévient la survenue des fibroses ou les cancers postcirrhotiques même si des études parcellaires le suggèrent. Il faudra du temps pour conclure. En revanche, son efficacité sur la normalisation des marqueurs biologiques ou sur la régression des lésions histologiques est prouvée; cependant le pourcentage avancé par les différentes études varie : 5 à 20% à long terme.
Car, et c'est là un point fondamental des études, les individus ne sont pas égaux devant la maladie. Le développement de la maladie vers la cirrhose est plus rapide chez les personnes âgées et chez les séropositifs. La réponse à l'interféron varie selon le type viral en cause. Les génotypes 1a et 1b, les plus fréquemment rencontrés lors des cirrhoses et des cancers, sont aussi ceux qui répondent le moins bien au traitement : on n'observe alors que 5% de réponses prolongées et, lorsque la charge virale est élevée, ce pourcentage tend vers zéro. Inversement un génotype 3 et une charge faible font espérer un tiers de réponses thérapeutiques. Faut-il donc choisir le malade avant de traiter ?
Disposer de critères prédictifs pour diagnostiquer, pour biopsier, pour traiter, c'est peut-être vers cet objectif que l'on tend aujourd'hui, dans un contexte qui ne peut oublier les impératifs économiques.
|
Le problème de santé publique représenté par la contamination d'un Français sur cent par le virus de l'hépatite C est loin d'être résolu. Quelques années seulement après la découverte du virus, il est illusoire d'espérer des réponses à toutes les questions qui se posent. Il faudra des études de cohortes, des évaluations, du recul pour affiner les connaissances. En attendant, les réponses sont claires et tiennent honnêtement compte de l'état actuel des connaissances. Nous présentons ici un résumé concis du texte court du consensus.
|
Les personnes qui ont été transfusées avant 1991 constituent un groupe à risque important : avant 1991, on évalue le risque transfusionnel à 6%. Aujourd'hui, le risque résiduel est estimé à 1/220 000. Le jury recommande au corps médical, et principalement aux généralistes, de sensibiliser les patients à ces éléments (la notion de dépistage systématique n'est pas évoquée pour ces patients).
L'outil de dépistage est le test Elisa de troisième génération, contrôlé par un second test en cas de positivité pour éliminer une erreur.
|
En l'absence de contre-indications, il existe un consensus pour traiter les hépatites chroniques nettement actives, cela en l'absence de cirrhose. Le sevrage alcoolique doit être effectif avant le traitement, dès qu'on est en présence d'une consommation supérieure à 20g par jour (2 verres). Un sevrage complet devrait être obtenu chez les toxicomanes.
Le jury estime que la constatation répétée de taux d'Alat normaux et l'existence de lésions hépatiques minimes font écarter le traitement. Ils arrivent à la même conclusion pour la cirrhose, en l'absence d'effet prouvé sur la survenue ou l'évitement du cancer hépatocellulaire. Les transplantés et les séropositifs ne doivent pas être traités.
En revanche l'interféron alopha est recommandé au cours des hépatites C aigües à la dose de trois millions d'unités trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Il réduit le risque d'évolution vers la chronicité.
|
|
| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Efficacité : clinique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Efficacité : Alat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Efficacité : ARN VHC | + | + | + | ||||||||||||||
| Tolérance : NFS, plaquettes | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Tolérance : TSH | + | + | + | + | + |
|
|
|
Les laboratoires distribuant l'interféron nous pardonneront ce petit jeu comptable, tant il est vrai que les chiffres sont sujets à caution. Cela dit, 600000 Français sont contaminés par le virus de l'hépatite C; 500000 ont une hépatite chronique plus ou moins active : dépistons-les, biopsions-les, éliminons ceux qui sont très âgés, ceux qui vont très mal, ceux qui vont très bien y compris sur le plan histologique. La moitié des patients atteints d'hépatite chronique sont justiciables d'un traitement. Faut-il traiter ces 250000 patients ?
Rappelons les chiffres présentés lors de la conférence de consensus : un patient sur mille (0.05% à 0.33%) mourrait des suites de la biopsie, soit, dans le cas présent, plusieurs centaines de morts (précisons qu'il faut s'adresser à une équipe entraînée). Environ 7%, soit 17500 souffriraient de dépression au cours du traitement. Et (les chiffres, toujours les chiffres !), 0.2% se suicideraient en raison du traitement (une étude européenne portant sur 2500 malades relève deux suicides et trois tentatives) : 500 morts (l'annonce de la maladie est-elle étrangère à cette funeste décision ?). Le nombre de suicides annuels étant évalué, en France, à 12000, on peut en conclure que traiter toutes les hépatites C qui le justifient augmenterait de 5% le nombre annuel de suicides...
Manipulons les chiffres différemment. Sur 500000 hépatites chroniques, environ 80000 deviennent des cirrhoses. Chaque année, 4% de ces cirrhoses se compliquent d'un carcinome hépatique, soit 3200 cancers du foie par an. En dix ans, 40% des cirrhotiques auront développé ce cancer dont la mort est malheureusement l'issue habituelle.
Peut-on mettre en balance dépression ou cirrhose, suicides ou cancers, hypothèses et certitudes, aujourd'hui ou demain ? Certes non. Que retenir de ces chiffres déroutants ?
Certainement ce que le jury de la conférence de consensus a retenu comme règle : on ne dépiste pas systématiquement, on informe les malades, on traite quand un bénéfice est attendu; surtout, on tente d'affiner les données épidémiologiques et les critères de sélection des malades à traiter. Ces choix sont des choix de médecins et non de comptables. Ecoutons donc le consensus.
|
Premier problème, la mortalité après biopsie. Si elle est réalisée dans de bonnes conditions, en milieu médical très spécialisé, avec, une fois qu'elle est réalisée, une surveillance style "salle de réveil", le pourcentage de décès ne dépasse pas 1/10000. Si l'on biopsiait les 600000 hépatites C, cela ferait 60 décès.
Les suicides sous interféron sont encore plus difficiles à évaluer, car il ne faut pas oublier que le suicide est une cause importante de décès dans notre pays et qu'un certain nombre de patients se seraient suicidés avec ou sans interféron. Les suicides liés au traitement, quand on connaît ce risque, ne me semble pas dépasser 1/10000. Si l'on traitait 200000 personnes, cela ferait 20 décès. Ce risque rappelle l'importance d'un suivi régulier et rapproché du malade par le généraliste, car la dépression peut apparaître au cours du traitement. Face à ces hypothèses, il faut afficher les chiffres de l'évolution naturelle de la cirrhoses : sans traitement, au moins 100000 personnes vont faire une cirrhose. En dix ans, 12000 en mourront.
Peut-on agir sur la fibrose et ralentir l'évolution de la maladie ? Les cliniciens en sont aujourd'hui convaincus. Des travaux préliminaires montrent que l'évolutivité de la cirrhose est moindre sous traitement. La conférence de consensus reflète une tendance moyenne, à mon sens trop conservatrice. L'AMM de la plupart des pays européens n'exclut pas les sujets cirrhotiques des traitements par l'interféron. Un essai randomisé et trois études rétrospectives suggèrent une diminution de l'incidence du cancer du foie sous interféron. Les résultats sont à confirmer mais nous laissons à ces malades le bénéfice du doute. Plusieurs essais randomisés ont démontré l'activité histologique de l'interféron par des traitements d'au moins douze mois, comme les méta-analyses les plus récentes. L'arrêt de l'interféron au troisième mois sur des critères uniquement biochimiques ou virologiques me paraît dangereux pour les malades, sauf si on leur propose un autre traitement antiviral. Des résultats préliminaires suggèrent même que l'interféron limite la vitesse de progression de la fibrose chez ces non-répondeurs biologiques, par rapport à leur évolution naturelle sans traitement.